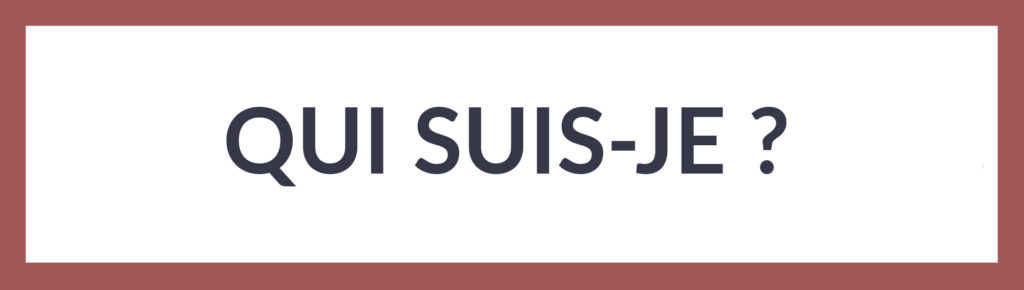Première précision préalable : de quel droit, je me permets d’appeler Vladimir Jankélévitch : Janké ?
Dans une émission radio sur lui, plusieurs personnes interviennent et soudain une dame, je n’ai pas retenu son nom dit :
(…) je lui ai dit oui, Janké, tu ne devrais…
Un autre participant lui dit « ha bon, tu l’appelais Janké ? » J’ai trouvé la remarque souriante… alors moi qui ne suis pas en âge de l’avoir connu, permettez-moi cette familiarité !
Dans la Kabbale, on explique que l’indicible est un mot de quatre consonnes sans voyelles dont seul le grand prêtre du temple de Salomon avait connaissance de la prononciation.
Puis, quand comme moi, on a entendu les témoignages des rescapés des camps ou quand on a vécu avec des enfants de déportés, victimes de la culpabilité du survivant qui se traduisait par « pourquoi m’ont-ils abandonné » ou « pourquoi je suis en vie et pas eux » ou pire encore « ils ont été assassinés parce que je n’étais pas sage » ou « je n’avais que 6 ans et je me sentais comme une vieille valise abandonnée sur la quai d’une gare » ou de cette attente d’Eliane Alisvaks qui, jusqu’à sa mort, quand quelqu’un sonnait à sa porte, ne pouvait s’empêcher de croire que c’étaient ses parents qui rentraient des camps. Forcément, ces termes d’indicible et d’ineffable sont omniprésents.
Indicible, ineffable et insaisissable
Selon Jankélévitch, l’ineffable, c’est ce qui ne peut être exprimé en mots sans être trahi. C’est ce qui ne se laisse ni conceptualiser, ni nommer, ni saisir pleinement, mais qui pourtant se donne à sentir, à pressentir, à vivre. L’ineffable est ce que l’on ne peut pas dire, mais que l’on ne peut pas ne pas éprouver.
Selon Jankélévitch, l’insaisissable désigne ce qui échappe à la pensée conceptuelle et à la prise du langage — non parce qu’il est vague ou flou, mais parce qu’il est trop subtil, trop mobile, trop pur pour être capturé sans le trahir.
Vladimir Jankélévitch c’est encore lui qui, le premier, avec toute son ironie, a exprimé le confort de l’antisémitisme en pantoufle en parlant de l’antisionisme – et ce dès 1986.
L’antisionisme est une incroyable aubaine, car il nous donne la permission — et même le droit, et même le devoir — d’être antisémite au nom de la démocratie ! L’antisionisme est l’antisémitisme justifié, mis enfin à la portée de tous. Il est la permission d’être démocratiquement antisémite. Et si les Juifs étaient eux-mêmes des nazis ? Ce serait merveilleux.
C’est aussi lui qui a exprimé l’inexpiable :
On peut tout pardonner, sauf ce qui est impardonnable. […] Le pardon est mort dans les camps de la mort.
Une pensée qui a entrainé son rejet total de l’Allemagne, comme c’était le cas chez ma grand-mère ou chez moi quand par exemple, je refuse d’acheter encore et toujours une voiture allemande ou de mettre les pieds en Allemagne.
Refus de pardonner si contraire à l’universalisme qu’exprimait si bien Missak Manouchian en disant “Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand.“
Après toutes ces précautions oratoires, toutes ces explications, voici le texte qui constitue l’objet de mon propos.
Ce que le silence murmure
“Ce que le corps vrillé exprime
Ce que la vieille valise abandonnée sur le quai d’une gare pleure
Il est des choses qu’aucun mot ne touche,
non parce qu’elles fuient,
mais parce qu’elles débordent.
On ne sait jamais ce que cache
la chape de silence.
L’ineffable,
c’est l’éclair d’un regard,
le frisson d’une grâce,
le souffle d’un amour si vaste
qu’il se dilue dans le ciel.
Il n’est pas muet,
il chante autrement
Il est trop plein pour se laisser enfermer.
À la naissance de l’instant,
on parle autour de lui
comme on danse autour d’un feu sacré,
sans jamais en percer le noyau.
L’ineffable est mystère,
non par absence,
mais par excès.
Et puis, il y a l’autre silence —
celui qu’on n’ose nommer.
L’indicible.
Ce ne sont plus ces quatre consonnes sans voyelles
Ce n’est plus le trop-plein,
c’est l’abîme.
Non plus ce qui éclaire,
mais ce qui brûle.
Ce qu’on ne dit pas
non parce qu’on ne peut,
mais parce qu’on ne doit.
L’indicible a des noms interdits,
des souvenirs clos à double tour,
des douleurs si nues
qu’une parole serait une trahison.
Il est de ces vérités
que le langage profane,
comme on profanerait un tombeau.
Ce n’est pas le silence du mystique,
c’est celui du survivant.
Un mutisme éthique,
un respect d’effroi.
Celui de la Shoah,
Celui de la culpabilité du survivant.
On ne sait jamais ce qui se
cache sous la chape de silence
Alors, entre l’ineffable et l’indicible,
le langage vacille.
Il tangue entre la lumière trop vive
et la nuit trop dense.
Entre le sacré qui déborde
et le sacré qu’on préserve.
Nous marchons sur ce fil.
Parfois, les mots glissent
et tombent dans le vide.
Dans l’interstice du temps,
Un souffle émerge,
L’infime, l’invisible,
Ce frémissement dans le silence des êtres.”
Première précision préalable : de quel droit, je me permets d’appeler Vladimir Jankélévitch : Janké ?
Dans une émission radio sur lui, plusieurs personnes interviennent et soudain une dame, je n’ai pas retenu son nom dit :
(…) je lui ai dit oui, Janké, tu ne devrais…
Un autre participant lui dit « ha bon, tu l’appelais Janké ? » J’ai trouvé la remarque souriante… alors moi qui ne suis pas en âge de l’avoir connu, permettez-moi cette familiarité !
Dans la Kabbale, on explique que l’indicible est un mot de quatre consonnes sans voyelles dont seul le grand prêtre du temple de Salomon avait connaissance de la prononciation.
Puis, quand comme moi, on a entendu les témoignages des rescapés des camps ou quand on a vécu avec des enfants de déportés, victimes de la culpabilité du survivant qui se traduisait par « pourquoi m’ont-ils abandonné » ou « pourquoi je suis en vie et pas eux » ou pire encore « ils ont été assassinés parce que je n’étais pas sage » ou « je n’avais que 6 ans et je me sentais comme une vieille valise abandonnée sur la quai d’une gare » ou de cette attente d’Eliane Alisvaks qui, jusqu’à sa mort, quand quelqu’un sonnait à sa porte, ne pouvait s’empêcher de croire que c’étaient ses parents qui rentraient des camps. Forcément, ces termes d’indicible et d’ineffable sont omniprésents.
Indicible, ineffable et insaisissable
Selon Jankélévitch, l’ineffable, c’est ce qui ne peut être exprimé en mots sans être trahi. C’est ce qui ne se laisse ni conceptualiser, ni nommer, ni saisir pleinement, mais qui pourtant se donne à sentir, à pressentir, à vivre. L’ineffable est ce que l’on ne peut pas dire, mais que l’on ne peut pas ne pas éprouver.
Selon Jankélévitch, l’insaisissable désigne ce qui échappe à la pensée conceptuelle et à la prise du langage — non parce qu’il est vague ou flou, mais parce qu’il est trop subtil, trop mobile, trop pur pour être capturé sans le trahir.
Vladimir Jankélévitch c’est encore lui qui, le premier, avec toute son ironie, a exprimé le confort de l’antisémitisme en pantoufle en parlant de l’antisionisme – et ce dès 1986.
L’antisionisme est une incroyable aubaine, car il nous donne la permission — et même le droit, et même le devoir — d’être antisémite au nom de la démocratie ! L’antisionisme est l’antisémitisme justifié, mis enfin à la portée de tous. Il est la permission d’être démocratiquement antisémite. Et si les Juifs étaient eux-mêmes des nazis ? Ce serait merveilleux.
C’est aussi lui qui a exprimé l’inexpiable :
On peut tout pardonner, sauf ce qui est impardonnable. […] Le pardon est mort dans les camps de la mort.
Une pensée qui a entrainé son rejet total de l’Allemagne, comme c’était le cas chez ma grand-mère ou chez moi quand par exemple, je refuse d’acheter encore et toujours une voiture allemande ou de mettre les pieds en Allemagne.
Refus de pardonner si contraire à l’universalisme qu’exprimait si bien Missak Manouchian en disant “Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand.“
Après toutes ces précautions oratoires, toutes ces explications, voici le texte qui constitue l’objet de mon propos.
Ce que le silence murmure
“Ce que le corps vrillé exprime
Ce que la vieille valise abandonnée sur le quai d’une gare pleure
Il est des choses qu’aucun mot ne touche,
non parce qu’elles fuient,
mais parce qu’elles débordent.
On ne sait jamais ce que cache
la chape de silence.
L’ineffable,
c’est l’éclair d’un regard,
le frisson d’une grâce,
le souffle d’un amour si vaste
qu’il se dilue dans le ciel.
Il n’est pas muet,
il chante autrement
Il est trop plein pour se laisser enfermer.
À la naissance de l’instant,
on parle autour de lui
comme on danse autour d’un feu sacré,
sans jamais en percer le noyau.
L’ineffable est mystère,
non par absence,
mais par excès.
Et puis, il y a l’autre silence —
celui qu’on n’ose nommer.
L’indicible.
Ce ne sont plus ces quatre consonnes sans voyelles
Ce n’est plus le trop-plein,
c’est l’abîme.
Non plus ce qui éclaire,
mais ce qui brûle.
Ce qu’on ne dit pas
non parce qu’on ne peut,
mais parce qu’on ne doit.
L’indicible a des noms interdits,
des souvenirs clos à double tour,
des douleurs si nues
qu’une parole serait une trahison.
Il est de ces vérités
que le langage profane,
comme on profanerait un tombeau.
Ce n’est pas le silence du mystique,
c’est celui du survivant.
Un mutisme éthique,
un respect d’effroi.
Celui de la Shoah,
Celui de la culpabilité du survivant.
On ne sait jamais ce qui se
cache sous la chape de silence
Alors, entre l’ineffable et l’indicible,
le langage vacille.
Il tangue entre la lumière trop vive
et la nuit trop dense.
Entre le sacré qui déborde
et le sacré qu’on préserve.
Nous marchons sur ce fil.
Parfois, les mots glissent
et tombent dans le vide.
Dans l’interstice du temps,
Un souffle émerge,
L’infime, l’invisible,
Ce frémissement dans le silence des êtres.”