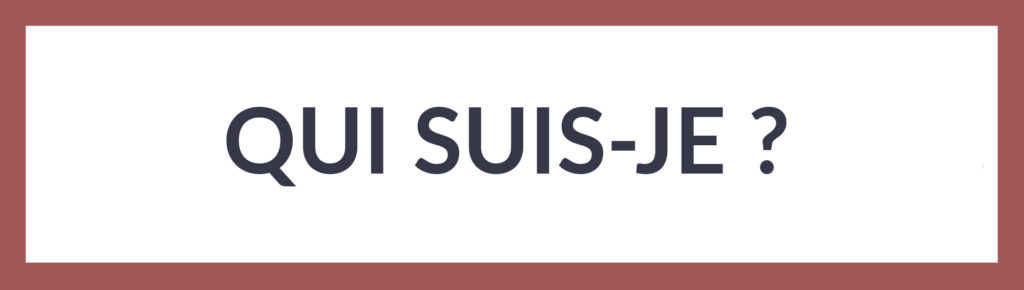Pétain avait quatre ennemis : les Juifs, les communistes, les francs-maçons et les gaullistes… et sur ces quatre, je me retrouve dans trois. Mon père, franc-maçon d’origine juive ashkénaze, et ma mère, fille d’une famille communiste de Cadillac-sur-Garonne, m’ont légué un héritage chargé de combats, de fidélités et de silences.
À peine sortie de l’enfance, ma mère est happée par la guerre. Engagée dans le réseau Buckmaster, elle participe aux parachutages d’armes britanniques dans la région, et prête sa voix anglophone — rare compétence — pour communiquer avec les aviateurs anglais. À la maison, dont une partie était réquisitionnée et occupée par un soldat allemand, les nuits se peuplent de murmures clandestins : mon grand-père et mes deux oncles, tous résistants, y organisent les livraisons d’armes pendant le sommeil de l’ennemi.
Parmi les récits qu’elle évoquait il y a ce voyage à vélo, les armes dissimulées dans un panier d’osier, jusqu’à Castillon-la-Bataille, à plus de 40 kilomètres. Son contact sur place n’étant pas présent au rendez-vous, elle dut faire demi-tour avec son colis intact, jeune et insouciante du danger.
Ma mère parlera plus tard de cette période comme une des plus belles années de sa vie — une jeunesse auréolée de bravoure et d’inconscience.
À la Libération, elle s’engage dans l’escadrille de Maryse-Bastié, première unité aérienne féminine de l’armée française. Mais lorsqu’on lui demande de participer à la guerre d’Indochine, elle refuse de bombarder des populations civiles et préfère démissionner, fidèle à ses principes. Elle rejoint alors un journal communiste bordelais, Les Nouvelles, où elle rencontre mon père.
Mon père fut lui aussi résistant, dès 1943, dans le maquis de Sistels, dans la 13ᵉ Compagnie de l’Armée Secrète du Tarn-et-Garonne. Avec mon grand-père Abraham, son instituteur Monsieur Debande et d’autres camarades, il fut arrêté sur dénonciation par la Milice et les SS. Assis sur la corde destinée à les pendre, ils ne durent leur salut qu’à l’intervention in extremis d’un commando du maquis, qui réussit à les échanger contre un officier allemand qu’ils avaient fait prisonnier.
Plus tard, lors de la libération de la pointe de Grave, mon père fit face à une autre épreuve : un officier nazi capturé allait être lynché. Il s’interposa, exigeant qu’il soit jugé selon les lois de la guerre — un sursaut d’humanité dans le chaos, motivé par une forte croyance dans la justice.
Mais si la Résistance nourrissait les conversations familiales, un lourd silence entourait la Shoah. Dix membres de la famille avaient été déportés, mais leurs noms restèrent tus à jamais. Ma mère, par pudeur ou loyauté devant la douleur de mon père, n’en parlait jamais. Elle ne demanda pas sa carte de résistante. Ce n’est qu’après la mort de mon père qu’elle reçut une médaille, remise par la maire de sa commune. Ce jour-là, mes enfants découvrirent l’héroïne qu’elle fut, et se pressèrent autour d’elle pour entendre, enfin, l’histoire de leur grand-mère.
Quant à mon père, il mourut dans une ignorance tragique : il croyait que son demi-frère Fernand était mort à Auschwitz, sans laisser d’héritiers. Il ne sut jamais qu’il avait eu des enfants avant d’être déporté…
Pétain avait quatre ennemis : les Juifs, les communistes, les francs-maçons et les gaullistes… et sur ces quatre, je me retrouve dans trois. Mon père, franc-maçon d’origine juive ashkénaze, et ma mère, fille d’une famille communiste de Cadillac-sur-Garonne, m’ont légué un héritage chargé de combats, de fidélités et de silences.
À peine sortie de l’enfance, ma mère est happée par la guerre. Engagée dans le réseau Buckmaster, elle participe aux parachutages d’armes britanniques dans la région, et prête sa voix anglophone — rare compétence — pour communiquer avec les aviateurs anglais. À la maison, dont une partie était réquisitionnée et occupée par un soldat allemand, les nuits se peuplent de murmures clandestins : mon grand-père et mes deux oncles, tous résistants, y organisent les livraisons d’armes pendant le sommeil de l’ennemi.
Parmi les récits qu’elle évoquait il y a ce voyage à vélo, les armes dissimulées dans un panier d’osier, jusqu’à Castillon-la-Bataille, à plus de 40 kilomètres. Son contact sur place n’étant pas présent au rendez-vous, elle dut faire demi-tour avec son colis intact, jeune et insouciante du danger.
Ma mère parlera plus tard de cette période comme une des plus belles années de sa vie — une jeunesse auréolée de bravoure et d’inconscience.
À la Libération, elle s’engage dans l’escadrille de Maryse-Bastié, première unité aérienne féminine de l’armée française. Mais lorsqu’on lui demande de participer à la guerre d’Indochine, elle refuse de bombarder des populations civiles et préfère démissionner, fidèle à ses principes. Elle rejoint alors un journal communiste bordelais, Les Nouvelles, où elle rencontre mon père.
Mon père fut lui aussi résistant, dès 1943, dans le maquis de Sistels, dans la 13ᵉ Compagnie de l’Armée Secrète du Tarn-et-Garonne. Avec mon grand-père Abraham, son instituteur Monsieur Debande et d’autres camarades, il fut arrêté sur dénonciation par la Milice et les SS. Assis sur la corde destinée à les pendre, ils ne durent leur salut qu’à l’intervention in extremis d’un commando du maquis, qui réussit à les échanger contre un officier allemand qu’ils avaient fait prisonnier.
Plus tard, lors de la libération de la pointe de Grave, mon père fit face à une autre épreuve : un officier nazi capturé allait être lynché. Il s’interposa, exigeant qu’il soit jugé
selon les lois de la guerre — un sursaut d’humanité dans le chaos, motivé par une forte croyance dans la justice.
Mais si la Résistance nourrissait les conversations familiales, un lourd silence entourait la Shoah. Dix membres de la famille avaient été déportés, mais leurs noms restèrent tus à jamais. Ma mère, par pudeur ou loyauté devant la douleur de mon père, n’en parlait jamais. Elle ne demanda pas sa carte de résistante. Ce n’est qu’après la mort de mon père qu’elle reçut une médaille, remise par la maire de sa commune. Ce jour-là, mes enfants découvrirent l’héroïne qu’elle fut, et se pressèrent autour d’elle pour entendre, enfin, l’histoire de leur grand-mère.
Quant à mon père, il mourut dans une ignorance tragique : il croyait que son demi-frère Fernand était mort à Auschwitz, sans laisser d’héritiers. Il ne sut jamais qu’il avait eu des enfants avant d’être déporté…
Pétain avait quatre ennemis : les Juifs, les communistes, les francs-maçons et les gaullistes… et sur ces quatre, je me retrouve dans trois. Mon père, franc-maçon d’origine juive ashkénaze, et ma mère, fille d’une famille communiste de Cadillac-sur-Garonne, m’ont légué un héritage chargé de combats, de fidélités et de silences.
À peine sortie de l’enfance, ma mère est happée par la guerre. Engagée dans le réseau Buckmaster, elle participe aux parachutages d’armes britanniques dans la région, et prête sa voix anglophone — rare compétence — pour communiquer avec les aviateurs anglais. À la maison, dont une partie était réquisitionnée et occupée par un soldat allemand, les nuits se peuplent de murmures clandestins : mon grand-père et mes deux oncles, tous résistants, y organisent les livraisons d’armes pendant le sommeil de l’ennemi.
Parmi les récits qu’elle évoquait il y a ce voyage à vélo, les armes dissimulées dans un panier d’osier, jusqu’à Castillon-la-Bataille, à plus de 40 kilomètres. Son contact sur place n’étant pas présent au rendez-vous, elle dut faire demi-tour avec son colis intact, jeune et insouciante du danger.
Ma mère parlera plus tard de cette période comme une des plus belles années de sa vie — une jeunesse auréolée de bravoure et d’inconscience.
À la Libération, elle s’engage dans l’escadrille de Maryse-Bastié, première unité aérienne féminine de l’armée française. Mais lorsqu’on lui demande de participer à la guerre d’Indochine, elle refuse de bombarder des populations civiles et préfère démissionner, fidèle à ses principes. Elle rejoint alors un journal communiste bordelais, Les Nouvelles, où elle rencontre mon père.
Mon père fut lui aussi résistant, dès 1943, dans le maquis de Sistels, dans la 13ᵉ Compagnie de l’Armée Secrète du Tarn-et-Garonne. Avec mon grand-père Abraham, son instituteur Monsieur Debande et d’autres camarades, il fut arrêté sur dénonciation par la Milice et les SS. Assis sur la corde destinée à les pendre, ils ne durent leur salut qu’à l’intervention in extremis d’un commando du maquis, qui réussit à les échanger contre un officier allemand qu’ils avaient fait prisonnier.
Plus tard, lors de la libération de la pointe de Grave, mon père fit face à une autre épreuve : un officier nazi capturé allait être lynché. Il s’interposa, exigeant qu’il soit jugé
selon les lois de la guerre — un sursaut d’humanité dans le chaos, motivé par une forte croyance dans la justice.
Mais si la Résistance nourrissait les conversations familiales, un lourd silence entourait la Shoah. Dix membres de la famille avaient été déportés, mais leurs noms restèrent tus à jamais. Ma mère, par pudeur ou loyauté devant la douleur de mon père, n’en parlait jamais. Elle ne demanda pas sa carte de résistante. Ce n’est qu’après la mort de mon père qu’elle reçut une médaille, remise par la maire de sa commune. Ce jour-là, mes enfants découvrirent l’héroïne qu’elle fut, et se pressèrent autour d’elle pour entendre, enfin, l’histoire de leur grand-mère.
Quant à mon père, il mourut dans une ignorance tragique : il croyait que son demi-frère Fernand était mort à Auschwitz, sans laisser d’héritiers. Il ne sut jamais qu’il avait eu des enfants avant d’être déporté…